Il y à 75 ans Robert Schuman proclamait, dans le salon de l’Horloge du Ministère des Affaires étrangères sa mémorable déclaration qui allait changer le visage, l’image et les rivages de l’Europe. Seulement cinq ans après la fin de la guerre avec l’Allemagne nazie naissait, à l’ouest du continent une entité politique inédite et originale dans l’histoire du monde alors que l’Est s’enfermait dans le soviétisme. La volonté des dirigeants politiques de l’époque était, en premier lieu, de créer un espace de paix et de stabilité. La communauté des Européens ne pouvait exister que par la réconciliation entre la France et l’Allemagne. Les fondateurs en étaient convaincus. Le premier chancelier allemand Konrad Adenauer s’est immédiatement engagé. Ces hommes avaient une vision du monde à venir. Le paradigme de l’unité européenne espéré depuis des décennies voyait le jour ce 9 mai 1950 et perdure aujourd’hui. La première visite officielle à l’étranger du chancelier Friedrich Mertz à Paris en est, s’il en faut, une preuve de cette volonté franco-allemande de faire avancer le projet européen.
Dès le début la construction européenne est fondée sur des valeurs fortes qui portent cette unité nouvelle. Nous les rappelons à chaque fois que cela est possible : la paix fondatrice, la liberté, la démocratie et la justice auxquelles s’ajoutent le respect de la dignité humaine et des droits de l’homme, l’égalité, l’État de droit qui garantissent une société basée sur le pluralisme, la tolérance, la solidarité et la non-discrimination. Préceptes fondamentaux partagés par les 450 millions d’européens et ingrédients centraux d’une culture commune encore trop peu connue et acceptée.
C’est sur ce socle de valeurs que repose notre citoyenneté européenne. Une citoyenneté commune qui complète notre nationalité sans jamais la remplacer. Mais c’est une citoyenneté qui offre un corpus de droits. On les connaît : la libre circulation, possibilités d’études, de travail et d’installation dans les autres pays membres, éligibilité et droit de vote pour les élections locales et européennes, représentation consulaire. On peut y ajouter l’initiative citoyenne européenne (ICE).
Cette citoyenneté on la reconnaît par les symboles que sont le drapeau, l’hymne, la monnaie, le passeport ainsi que la Journée de l’Europe du 9 mai et la devise forte : unie dans la diversité. Elle signifie que chaque peuple a et garde sa culture et chacun participe, selon les valeurs adoptées, à la construction de l’entité politique commune.
Mais est-ce pour autant qu’existe un vrai sentiment d’appartenance à l’UE ? Rien n’est moins sûr. Il semble, en tout cas, moins fort qu’il n’a été. Citoyens européens nous sommes certes. Mais nous pouvons nous interroger : existe-t-il une forte conscience collective pour nous unir ? Les valeurs sont-elles partout communes ? la montée des extrêmes droites dans plusieurs pays nous questionnent.
Faire du 9 mai un jour férié et chômé pour tous les Européens
Ces valeurs, nous en avons les symboles sous les yeux tous les jours mais c’est manifestement insuffisant. D’ailleurs sont-elles intégrées dans les consciences ? Sommes-nous éduqués à l’importance de l’Union européenne à un moment où le monde est en train de basculer et au moment où les particularités sont en insurrection ? Sur la couverture du passeport il est écrit en Union européenne. Mais peut-être faut-il voyager dans un pays tiers à l’UE pour se rendre compte de notre appartenance et des avantages de l’Union. Schuman avait dit : « la Communauté européenne n’a pas vocation à devenir un État ». Et personne ne le souhaite ou l’évoque aujourd’hui. Tout au plus parlons-nous de fédéralisme ou de confédéralisme. Les mots font peur alors que dans l’entre-deux-guerres c’était un débat récurrent qui s’est quelque peu poursuivi ensuite. Pourtant l’Europe avance chaque jour, crises après crises qui sont constitutives d’une Europe puissance. Chaque État a transféré des compétences vers la dimension supranationale, gérées souverainement par chaque et l’ensemble des pays membres.
Face à la Russie de Poutine, les USA de Trump ou la Chine de Xi, la situation géopolitique internationale que nous connaissons ouvrent le regard que portent les Européens sur leur Union. Mais, il faut bien le reconnaître, nous ne regardons pas tous les situations avec le même regard. Il n’y a pas toujours d’européanité. Il manque quelque chose de fort à tous les Européens pour vivre pleinement en tant que tel et avec fierté. La Journée de l’Europe est le temps idéal mais pour ce faire, pour connaître une efficacité le 9 mai devrait, doit devenir un jour férié pour tous les Européens. Le Parlement européen en a convenu mais pas les États. Le 9 mai n’est donc pas un jour férié officiel en France ou dans la majorité des pays européens, mais seulement un symbole de l’unité et de la paix européennes. Elle reste une simple journée de célébration, d’événements, de manifestations, et de sensibilisation à l’Union européenne. Ce n’est pas assez pour développer un sentiment d’appartenance et la reconnaissance de l’existence d’une culture commune. Il faut aller beaucoup plus loin et plus fort. Il y a encore du chemin à parcourir.






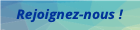
Derniers commentaires