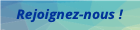« On mesure l’intelligence d’un individu à la quantité d’incertitudes qu’il est capable de supporter. » Si l’on s’en tient à cette définition d’Emmanuel Kant, le Coronavirus a fait beaucoup de ravages et les Français ont cessé d’être le peuple le plus intelligent de la terre… Il suffit de constater le caractère nombriliste de notre vision du monde soudain rétréci aux limites de l’Hexagone.
Cette crise d’une ampleur inédite et déconcertante a pris tout le monde de court, à commencer par les scientifiques qui, délaissant leur prudence habituelle, se sont pris, sous les feux des médias, à multiplier les annonces péremptoires, mais très vite contredites, au grand dam des gouvernants qui auraient préféré fonder leur action sur des vérités mieux établies.
Le fait même qu’on parle d’épidémie plutôt que de pandémie traduit notre incapacité à partager une vision globale, porteuse de solidarité internationale.
En France, on a longuement focalisé la polémique sur la question des masques : une aubaine pour des oppositions en quête de revanche qui ont trouvé là l’occasion de transformer les légitimes appréhensions en peurs paniques, d’agglutiner les « colères », selon le processus habituel, et d’instruire le procès du gouvernement en impéritie. Comme s’il était plus important de chercher des responsables que des solutions !
Les masques étant maintenant disponibles par millions (on verra combien il restera d’invendus et d’inutilisés lorsque la crise sera passée), on se chamaille sur les modes de distribution, on ironise sur la couleur du masque que portait le président de la République lors d’une visite dans une école de banlieue parisienne. Il reste encore l’agitation bruyamment entretenue sur les réseaux sociaux, à grands coups de fake-news et de déclarations fracassantes sur tel ou tel remède miracle, comme si la vérité scientifique se décidait à l’applaudimètre…
Les collectivités locales qui demandaient qu’on les laisse agir au plus près du terrain se plaignent aujourd’hui que l’État se défausse sur elles de ses responsabilités. On se bat sur l’ouverture des établissements scolaires, sur l’accès aux plages, sur l’ouverture des parcs et des jardins, etc., etc.
Et pendant ce temps, qui regarde ces longues files d’Indiens faméliques que le virus a chassés des grandes villes, les privant du maigre travail qui leur permettait de survivre et du bout de trottoir où ils dormaient, pour tenter de rejoindre un village éloigné, sans certitude d’y arriver, ni d’y retrouver encore leur famille ?
Surprenants, révoltants ces appels au droit de retrait et ces préavis de grève lancés par des agitateurs professionnels en pleine crise sanitaire, quand l’urgence sociale rejoint l’urgence économique (déjà 450 000 emplois perdus) ! Surprenantes, révoltantes aussi ces tribunes et ces pétitions de people indignés, prompts à donner des leçons là où ils auraient plutôt besoin d’en prendre ! On en vient à se demander si le nombre de leurs cellules grises ne serait pas inférieur à l’épaisseur de leurs comptes en banque. Ils veulent des actes, non des mots… comme si bien nommer les choses n’était pas une urgence, comme si la justesse des analyses n’était pas la condition nécessaire du succès de l’action publique, comme si la seule émotion pouvait primer sur la recherche pragmatique, permanente, exigeante de l’intérêt commun.
La patience est de rigueur, même en phase d’urgence. Il serait du devoir des médias et des politiques de le rappeler à une opinion publique mal préparée à l’épreuve du temps long.
Pendant la seconde guerre mondiale, il y avait dans les maquis de la Résistance des Français de tous les âges, de tous les milieux sociaux, de toutes les sensibilités. Celui qui croyait au ciel était le frère d’armes de celui qui n’y croyait pas. Le communiste côtoyait le royaliste, l’ado exalté le vieil humaniste. Ces Gaulois réfractaires savaient faire taire leurs querelles, tous avaient la même peur au ventre, ils partageaient le même amour du pays, la même exigence de liberté.
Cette solidarité courageuse, les soignants l’ont manifestée au quotidien ; leur dévouement, leur abnégation, leurs compétences ont sauvé des milliers de vies. La nation leur en est unanimement reconnaissante, mais elle ne semble hélas pas toujours prête à leur emboîter le pas.
Pendant la guerre, à côté des résistants, il y avait des collabos convaincus ou passifs, avoués ou honteux, des gens plus préoccupés de préserver leur petit confort que d’autre chose. Demain, leurs émules se retrancheront derrière leurs droits acquis pour refuser de redoubler d’efforts : on ne va pas répondre aux injonctions du patronat – oubliant au passage que ce prétendu régime néo ou ultralibéral a tout de même fait vivre les 4⁄5 des Français sur le budget de l’État pendant de longues semaines.
D’autres rêvent à l’émergence d’un nouveau monde, ils se bercent (devrais-je dire : nous bercent ?) d’illusions en multipliant les appels à changer l’ordre des choses : « Rien ne sera plus comme avant ! » Nouvelle version des lendemains qui chantent ? Chacun y va de sa démonstration ; il faut s’attaquer aux fondements du système : la cause de la pandémie, c’est le capitalisme, la mondialisation, le non respect de la biodiversité, le réchauffement climatique, les énergies fossiles, le rejet des religions (cochez la bonne case !)…
Même en excluant les délires complotistes, la liste est longue, chacun préempte pour sa cause, par pur opportunisme idéologique. Car ils savent très bien au fond d’eux-mêmes, qu’il sera impossible de répondre à tous ces impératifs à la fois : dire que tout est prioritaire relève à l’évidence de la démagogie, non de l’esprit de responsabilité. On exige que tout change pour que rien ne change. Et tant pis si les inégalités qu’on dénonce à grand renfort de tribunes médiatiques persistent, ce sera bien entendu la faute de gouvernants incompétents, sourds aux légitimes revendications des peuples. En un mot, on organise l’inefficacité du verbe pour prolonger l’inutile logorrhée.
Il est pourtant clair qu’après la crise, le malade aura besoin de respirer. Il faudra d’abord continuer à vivre, nous remuscler, relancer l’économie, préserver ce qu’il restera d’emplois, créer d’autres métiers, retrouver ce qui fait sens, savourer à nouveau notre art de vivre à la française. La réponse est dans le civisme, non dans le cynisme. Je ne suis pas certain que la décroissance que le Coronavirus nous a imposée et dont nous sommes loin de mesurer tous les effets négatifs soit le modèle de la future société idéale.
Chacun sait que si nous avons des faiblesses, nous avons de solides atouts, des capacités de résilience et des réserves de créativité que la crise a révélés. La seule stratégie qui vaille est de corriger les unes et de valoriser les autres. Nos facultés de riposte existent : scientifiques, économiques, culturelles, mais les réponses ne pourront pas s’inscrire dans les seuls cadres nationaux. A quelques exceptions près, la crise a montré la tendance de chaque pays à se replier sur lui-même, à réagir en ordre dispersé – comme lors de l’afflux des migrants. L’Europe devra repenser demain son rapport à la subsidiarité, ouvrir de nouveaux champs de compétences partagées et renforcer le multilatéralisme dont la communauté scientifique internationale a mesuré l’intérêt, loin des populismes américains, britanniques ou brésiliens qui ont montré que c’était dans le pire qu’ils étaient les meilleurs.
On réfléchit beaucoup à ce que sera demain, sans même savoir quand commencera ce demain, sans savoir quelle sera l’étendue du champ de ruines, ni dans quel état nous serons au sortir de ce marasme universel. Une chose est sûre : il nous faudra rebâtir patiemment avec tous les bras, toutes les intelligences positives, toutes les énergies disponibles. C’est à ce prix et à ce prix seulement que l’épidémie ne sera plus qu’un épisode de notre histoire.
Claude Oliviéri 8 mai 2020