Au moment où la passation entre l’ancienne et la nouvelle Commission européenne est opérée, les défis et enjeux qui se présentent aux Européens sont nombreux. Se voulant concret et symbolique le premier déplacement à Kyiv du président du Conseil européen, António Costa, de la Haute représentante de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Kaja Kallas, et la commissaire chargée de l’élargissement, Marta Kos, est l’illustration concrète d’une situation réelle qui touche chacun des pays membres de l’UE.
C’est un signe d’autant plus prégnant que le monde connaît une période de grande instabilité politique, économique et culturelle. Les conflits sont latents. Les compétitions entre États-continents sont devenues des réalités que les institutions nationales et européennes semblent avoir du mal à saisir et les médias des difficultés à informer de manière exhaustive.
Un peu partout existe un glissement vers des droites radicales en réaction à des échecs de gouvernements sur des évolutions économiques, sociales et, il faut le dire, des changements sociétaux. Ils réagissent aussi parfois aux contre-coups aux migrations, voire et souvent à un sentiment d’insécurité.
La Chine s’impose sur les marchés qui faisaient autrefois la gloire des occidentaux et en particulier sur les secteurs automobiles, du numérique, de l’IA ou encore celui des panneaux solaires. L’Inde s’impose dans les domaines du numérique ou de l’industrie pharmaceutique. Il est vrai que depuis des décennies des délocalisations font à ces pays de somptueux cadeaux que les États et groupes industriels regrettent aujourd’hui. En réaction, le consommateur commence à regarder d’un mauvais œil un produit banal qui traverse les océans et parcourt des milliers de kilomètres maritimes ou aériens pour atterrir dans nos GMS.
Ainsi, la mise en perspective par l’UE de la zone indopacifique est un objectif prioritaire pour la Commission car la zone connaît une croissance massive tant en terme économique que de populations. En termes commerciaux et industriels, mais aussi de stabilité, le défi est majeur.
Si l’on rajoute la guerre d’invasion que mène la Russie contre l’Ukraine, la déstabilisation du Moyen Orient, l’émergence des BRICS augmentés de 20 pays, un réchauffement climatique auquel on tente de s’adapter, on voit clairement que la nouvelle Commission sous la présidence d’Ursula von der Layen va devoir agir en finesse, efficacité et rapidité. Si elle doit rechercher le consensus, cela implique que les États membres soient absolument solidaires. Le jeu personnel de certains dirigeants, comme celui auquel se livre le PM hongrois Viktor Orban est à bannir. Optimiste, j’espère que la méthode communautaire devra permettre d’arriver à des accords.
Les défis sont nombreux.
Nous le savons, les défis qui se présentent sont nombreux. Essayons d’en regarder quelques-uns. La liste n’est malheureusement pas exhaustive.
Le premier et le plus urgent est le retour à la paix sur le continent européen. C’est essentiel car c’est l’essence même, la première des motivations du projet européen. C’est sur cette base que s’est construite la communauté européenne. « Plus jamais la guerre sur le continent européen » clamait, en 1948, au congrès de La Haye le Premier ministre britannique Winston Churchill. Deux ans plus tard la déclaration de Robert Schuman concrétisait le propos. Depuis cette date, c’est vrai, il n’y a pas eu de conflit entre pays signataires. Cela dure alors depuis plus de sept décennies. Rappelons qu’une guerre éclatait auparavant entre nos pays en moyenne tous les trente ans ; il est bon de le souligner. Avec la guerre à nos frontières, il faut donner aux Ukrainiens les moyens de la paix.
Un deuxième concerne la compétitivité et le risque de décrochage économique auquel l’UE est confrontée. Mario Draghi dans son rapport remis à la présidente de la Commission propose trois orientations fondamentales pour relancer une croissance « durable » : innover et combler le retard technologique, définir un plan commun pour la décarbonation et la compétitivité, et renforcer la sécurité et réduire les dépendances.
Le troisième n’est pas si simple à mettre en œuvre. Il s’agit de la décarbonation, c’est-à-dire l’ensemble des mesures permettant au secteur industriel, à l’économie, à l’UE, aux États, entreprises et citoyens de réduire l’empreinte carbone. Il s’agit d’agir avec efficacité pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, dioxyde de carbone (CO2) et méthane (CH4) principalement, afin de limiter l’impact sur le climat.
Le quatrième défi est sans conteste celui des migrations. Le Conseil s’efforce de mettre en place une politique migratoire européenne efficace, humanitaire et sûre. Celle-ci doit tenir compte de nombreuses complexités que les dirigeants comme les citoyens doivent prendre en compte. Il concerne la démographie fortement en baisse au sein de l’UE comme la résolution des besoins actuels et futurs en matière de main d’œuvre. La démographie qui devrait faire l’objet d’une politique commune tant elle met en cause des éléments, économiques, culturels et sociaux. C’est une question majeure que l’on ne peut mettre de côté.
Un cinquième défi est celui de l’élargissement. Il est important car l’UE pour peser dans le monde tant dans les domaines de l’économie que géostratégiques a besoin d’un nombre critique de citoyens. En août 2023, le président du Conseil européen, Charles Michel, déclarait que l’Union européenne devait être prête à intégrer de nouveaux membres d’ici 2030. Mais cela ne doit se faire sans une analyse critique sérieuse afin d’en saisir le bien fondé. La question de la citoyenneté commune, du nécessaire sentiment d’appartenance sont à prendre en compte et pas uniquement les problèmes institutionnels qui, inévitablement, vont se présenter. Un nouveau traité se profile. Ce sera un travail préparatoire pour la nouvelle législature. En attendant, la porte est ouverte à près de dix pays demandeurs dont l’Ukraine et la Moldavie. Pour l’instant, cinq pays des Balkans occidentaux ont obtenu le statut de candidats : Macédoine, Monténégro, Albanie et Bosnie-Herzégovine.
Certes, ces pays devront satisfaire aux exigences des critères de Copenhague mais pas seulement. Les dimensions politiques, culturelles sont au cœur de leur acceptation.
Que doit faire l’Union européenne face à de telles situations ?
Revenir avec force dans le jeu international et conscientiser au niveau des politiques intérieures. C’est l’ambition affichée par les dirigeants européens. Pour ce faire, l’UE doit se construire un agenda géopolitique nouveau et l’expliquer. Il est important pour les citoyens de l’UE, pour les relations entre les États membres, mais il doit devenir lisible à l’extérieur de l’UE. C’est un signe fort pour les régions et États du reste du monde notamment au moment où certains accords économiques sont fortement discutés pour ne pas dire contestés.
Parlons de la défense. Si une armée européenne est une vision de l’esprit dans le contexte actuel faute d’une politique commune et diplomatie dédiée, il est important de souligner l’existence de mesures concrètes et identifiées dans le cadre de la stratégie industrielle de défense européenne (EDIP – The European Defence Industry Programme). Un objectif est d’augmenter le soutien financier. De même, il convient d’assurer la disponibilité et l’approvisionnement des produits de défense. Sur cette question, promouvoir la coopération avec l’Ukraine est essentiel.
Enfin, et c’est un enjeu central, l’UE doit réaffirmer avec force ce qu’elle est et ce qu’elle n’est pas. Elle n’est pas un État. Schuman avait d’ailleurs insisté sur ce fait. Mais elle est plus qu’un marché intérieur. Elle est un territoire de valeurs, d’appartenance et de citoyenneté.
Autrement dit, l’UE est une construction politique et pas seulement un ensemble économique. Pour fonctionner, elle doit obtenir l’adhésion de ses citoyens et leur appui. Ils répondent, souvent inconsciemment, à une culture commune. Ensemble, tous font civilisation.
C’est ce travail qui doit être mis en œuvre dans les mois à venir. Sans oublier que la subsidiarité réelle doit être au cœur des projets. Nous sommes attachés à nos cultures et souhaitons les préserver. C’est notre richesse et ce qui fait nos identités multiples.
L’UE n’est pas une uniformisation. Sa devise l’affirme. Les citoyens l’ont finalement exprimé lors des dernières élections.
La nouvelle direction de l’UE est en place.
La présidente Roberta Metsola (Parlement européen), la présidente Ursula von der Leyen (Commission européenne) et le président António Costa (Conseil européen) se sont retrouvés le 2 décembre, lendemain du début des nouveaux mandats de la Commission et du Conseil.
Le 1er décembre, António Costa a pris ses fonctions de président du Conseil européen. Organe principal de l’UE. En son sein les chefs d’État et de gouvernement des pays membres définissent l’orientation politique et les priorités de l’UE.
Le même jour, Ursula von der Leyen a entamé son deuxième mandat à la tête de l’institution exécutive de l’UE, après que le Parlement ait examiné et approuvé son équipe.
Le mandat de cinq ans du Parlement a commencé après les élections européennes de juin, après que les Européens aient voté au suffrage universel pour leurs représentants.



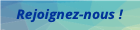
Bonne synthèse Emmanuel. Les principaux défis sont bien exposés.
Kenavo
Très intéressant Emmanuel, bravo