L’Union européenne doit répondre vite et efficacement aux périls qui montent (guerre en Ukraine, crises énergétique et climatique, affaiblissement du multilatéralisme, guerre commerciale). Dans ce contexte géopolitique durable, il est utile de revoir l’histoire de Galileo, l’ambitieux système européen de radionavigation lancé au début des années 2000, pour tirer les leçons des erreurs passées et identifier les clés de la réussite pour les projets industriels majeurs dont l’Union a besoin aujourd’hui.
Galileo est un système de positionnement par satellites, actuellement le plus précis du monde, qui a été mis en place par l’Union européenne (UE). Il est nommé Galileo en hommage au savant italien qui a identifié la notion de satellite et il sert dans de nombreux domaines : téléphonie mobile, sécurité civile, transports maritimes, aériens et terrestres, opérations de secours et de sauvetage, travaux publics, prospection pétrolière, agriculture, ou tout simplement dans la vie de tous les jours. Galileo dessert plus de trois milliards d’usagers sur la planète. Contrairement aux systèmes américain GPS et russe Glonass, il a principalement été conçu pour un usage civil.
Un peu comme Airbus dans le domaine de l’aviation ou Ariane dans le secteur aérospatial, Galileo est un outil stratégique pour l’autonomie de l’Union. Il permet de se libérer d’une dépendance critique vis-à-vis des systèmes concurrents (GPS américain, GLONASS russe ou Beidou chinois) qui souffrent de nombreuses restrictions, pour des raisons techniques et/ou politiques.
L’idée d’un réseau transeuropéen de ce type nait en 1998 et prend la forme d’un partenariat public/privé à vocation commerciale qui est lancé en mai 2003. Il résulte d’un accord entre l’Union européenne et l’Agence spatiale européenne chargée du segment spatial. De fortes oppositions se manifestent, notamment celle des États-Unis qui ne souhaitent pas que des pays ou des organisations ennemis y aient accès et qui défendent leur monopole en matière de télécommunication satellitaire. Un accord d’interopérabilité technique permet de lever l’opposition, la même chose étant faite avec les systèmes russe Glonass et chinois Beidou. De nombreux autres pays participeront, à différents niveaux de coopération, notamment la Chine, l’Inde, Israel, le Maroc, l’Ukraine, la Norvège en 2009 et la Suisse en 2013.
Dans un premier temps, en 2005 une concession est attribuée à deux consortiums qui assure les 2⁄3 du financement du programme, le reste l’étant sur fonds publics de l’Union européenne et l’Agence spatiale européenne (ESA). De très nombreux obstacles se présentent du fait de la rivalité entre États, notamment entre l’Italie et l’Allemagne, de la difficulté à choisir un consortium, puis à définir le leadership entre les deux consortiums concurrents. Le calendrier initial est reporté de cinq ans, jusqu’à l’abandon du partenariat public privé en 2007 et la dissolution de l’entreprise commune Galileo fin 2006. La Commission européenne plaide alors pour un financement public complet des trente satellites du futur système de navigation, qui sera exploité par le privé, une fois opérationnel.
Les États membres et le Parlement européen finissent par s’accorder sur ce financement entièrement public, l’attribution par ESA des appels d’offres en six lots pour la phase opérationnelle du programme permettant de calmer les différends entre les pays participants. Fin 2010, un besoin de financement supplémentaire apparait et on risque un report à 2017, voire 2018. Berlin veut ensuite réduire le coût de 500 à 700 millions d’euros en utilisant des lanceurs russes Soyouz depuis la base de Kourou, ce qui sera fait entre fin 2011 et 2016. À compter de fin 2016, avec Ariane 5, le démarrage opérationnel de la constellation accélère et entre fin 2017 et mi 2018, une couverture viable existe en tout point du globe.
Le succès de Galileo est à saluer, tant les obstacles ont été nombreux, l’exploitation commerciale étant à l’origine prévue pour 2008. D’après la Cour des comptes européenne dans un rapport spécial 7/2009, le grand retard accumulé est lié à plusieurs problèmes : d’abord un échec des structures de gouvernance entre les différents intervenants mais aussi un manque de clarté dans les priorités entre équilibre financier et bénéfices macroéconomiques. Il faut aussi un financement adéquat dans un domaine stratégique comme l’espace où les rendements sont à long terme et où les mécanismes de marché fonctionnent mal. Le financement intégral par le budget européen décidé fin 2007 permet de lever l’obstacle. Elle permet aussi de contourner les rivalités interétatiques (le « juste retour ») qui complexifie l’organisation de la politique industrielle européenne.
Au final, Galileo est la première infrastructure commune produite et financée par l’UE, qui en est également propriétaire. La Commission européenne gère et supervise le projet par l’intermédiaire d’une agence (EUSPA), autorité européenne de surveillance. Le contractant principal est l’Agence spatiale européenne de nature intergouvernementale. Mi 2024, avec le positionnement de 30 satellites, dont 6 de rechange, le système est pleinement opérationnel. Toutefois, dix années ont été gaspillées, certains faisant valoir que l’avantage comparatif européen et l’avance du système par rapport aux systèmes concurrents (six à huit ans) ont été perdus. Et l’Union est en train de perdre son avance (en 2024, elle a dû faire appel aux lanceurs américains Space X).
L’UE a‑t-elle aujourd’hui dix années à perdre alors qu’elle décroche vis-à-vis des autres grands ensembles économiques ? Fin 2024, trois rapports1 s’accordaient sur ce décrochage et sur l’urgence pour l’Union de remédier aux failles dans sa sécurité économique et son autonomie stratégique. Dans l’un de ces rapports, Mario Draghi annonce que, sauf rattrapage urgent et déterminé, l’UE est condamnée à une « lente agonie » : il lui faut une politique industrielle intégrée en faveur de l’innovation et de la compétitivité, ce qui requiert un besoin d’investissement de quelque 800 milliards d’euros par an, c’est-à-dire 4 à 5% du PIB européen. Pour le seul domaine spatial, compétence partagée avec les États membres depuis le traité de Lisbonne, près de 15 milliards d’euros sont consacrés par l’UE sur la période 2021–2027, dont environ 9 milliards pour Galileo. Mais les financements sont insuffisants (le budget de l’UE pèse 1% du PIB) et fragmentés : l’essentiel étant issu des budgets nationaux, le risque est de multiplier les doublons et de perdre les économies d’échelle.
Les solutions existent, nouvel emprunt commun sur le modèle du plan de relance post Covid de 2020 ou mobilisation de l’ample épargne européenne qui est actuellement mal allouée et peu sollicitée. L’histoire du GPS européen donne une idée des combats du présent et de l’avenir. Avec la nouvelle donne géopolitique, la défense de nos intérêts stratégiques n’autorise pas la tergiversation, ni la rivalité entre égoïsmes nationaux. Elle requiert au contraire coopération et détermination, en assumant les coûts immédiats de notre autonomie, en évitant de répéter les erreurs du passé. C’est ainsi que l’Europe gagne.
1 Mario Draghi sur la compétitivité de l’UE (The Future of European Competitiveness), Enrico Letta sur le marché intérieur (Much More Than a Market) et Sauli Niinistö sur la sécurité et la dense européennes (Safer together: A path towards a fully prepared Union).


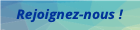
Félicitations Catherine pour cette analyse approfondie d’un sujet qui apparait trop peu sur nos radars européens,
vive Galileo « envers et malgré tout »
Cordialement
Olivier