L’électeur ou l’électrice qui ne trouvera pas chaussure à son pied, ou du moins candidat à son goût, lors du scrutin des européennes ce 9 juin prochain ne pourrait s’en plaindre qu’à lui-même ! De fait, pas moins de 37 listes de 81 candidats se proposent à son choix : pour peu, il faudra bientôt récompenser celles et ceux qui ne se sont pas portés en lice !
Un premier constat : ce n’est pas la première fois que le Parlement de Strasbourg suscite une telle mobilisation des amateurs de combats ou de débats ! En 2019 déjà, le total des postulants avait dépassé la trentaine ! Mais ce chiffre nous interpelle à plus d’un titre, et d’abord parce que parmi les postulants certains seraient bien en peine de dire l’Europe qu’ils veulent, si tant est qu’ils en veuillent une ! Comme Ferdinand Lop au Quartier latin il y a une génération, ils sont candidats à tout scrutin, histoire de parler et… de faire parler d’eux. Et quand bien même la consultation et les pouvoirs de l’Assemblée à laquelle officiellement ils postulent n’auraient aucun rapport avec la cause pour laquelle ils entrent en lice. C’est là ce que les politologues appellent la fonction tribunicienne des consultations électorales, et elle est à tous égards un mal pour un bien.
Tout de même, l’aspect matériel de la consultation interpelle bien des élus locaux ; il suffit pour mesurer leur désarroi de constater le monocorde et interminable alignement des panneaux électoraux, la loi obligeant à ce que chaque liste en dispose d’un en propre, tiré au sort, en plus du panneau officiel de l’Administration stipulant les conditions du scrutin. Le souci est louable : garantir la plus parfaite équité entre les postulants. Mais ce souci tourne à la caricature devant la multiplication des vocations.
De fait, dans certaines petites communes au budget très restreint, la dépense a été de taille, et elle est d’autant plus amère que la plupart de ces panneaux resteront vierges de tout revêtement, nombre de listes rechignant, faute de militants et de moyens, à afficher.
Il est vrai que la simple addition du nombre des communes sur le territoire national, outremer compris, a de quoi épouvanter les Trésoriers de formations politiques parfois très modestes qui devraient tirer plusieurs centaines de milliers d’affiches, et ensuite aller les apposer, ou mandater pour ce faire des équipes spécialisées et rémunérées, pour une performance hypothétique face à probablement un million de panneaux sur l’ensemble de la circonscription électorale unique.
Rappelons qu’il faut au moins 3% des votes pour prétendre au remboursement par l’État, et à concurrence de plafonds fixés au plus juste, des frais de campagne ainsi engagés.
Le même constat sera fait en matière de bulletins de vote, où le total théorique est d’autant plus important que l’usage veut qu’on en envoie un avec un tract à chaque électeur par la voie officielle avant la consultation, et que d’autres se retrouvent, et en quantité suffisante, sur la table d’accueil du bureau de vote ! Là encore, les records seraient battus, et des centaines d’arbres abattus, y compris ‑paradoxe apparent- pour des appels plus ou moins confidentiels à … protéger la nature et préserver les forêts ! Sans doute verra-t-on à nouveau des formations modestes en appeler au sens pratique de l’électeur, invité à imprimer chez lui le bulletin de vote de la liste avant d’aller aux urnes. Mais ce réflexe avant-gardiste reste pour le moins confidentiel.
Une autre charge indirecte de cette journée pèsera sur les volontaires, ou volontaires désignés d’office en tant qu’élus locaux, chargés de tenir les bureaux de vote, puis de dépouiller après clôture de la consultation… à 22h, sous prétexte de ne pas influer sur le vote des Italiens qui, eux, ont coutume de passer aux urnes jusqu’à une heure aussi tardive. Reste que pour les habituels assesseurs, et surtout pour ceux qui travaillent le lendemain, la charge d’heures risque de peser et de décourager les vocations déjà bien rares, pour une fonction il est vrai tout juste un peu honorifique et en tout cas non rémunérée.
Néanmoins, et malgré cette accumulation d’éléments en apparence dissuasifs, une telle abondance de candidats ne me semble pas être un élément négatif : d’abord parce que, en matière d’Europe comme sur bien d’autres points, tout ce qui permet aux citoyens et à leurs représentants, ou à ceux qui ambitionnent de l’être, de s’exprimer ne peut qu’être positif.
Certes, dans le cas présent, le fait qu’il n’y ait qu’un tour, et une barre à 5% pour obtenir des sièges, peut être considéré comme un obstacle dissuasif, tant le choix est difficile et les nuances entre certaines listes infiniment peu claires.
Il n’en demeure pas moins que l‘intérêt ainsi manifesté par le personnel politique ou associatif ne peut que servir la démocratie. Il nous rappelle aussi que chaque consultation électorale porte en elle une ambigüité fondamentale, qui peut paraître comme l’adjonction d‘éléments contraires : d’une part permettre l’expression de l’opinion de la « base », et d’autre part désigner une équipe de responsables à qui incombera la gestion de la collectivité ainsi considérée, pour la durée du mandat.
Et de fait, en soi, ces deux priorités sont antinomiques, surtout dans un scrutin à un tour. De plus, une telle campagne électorale pour le moins pluraliste s’accompagne de multiples prises de position, articles, discours, motions et émotions dont la teneur ne peut échapper aux dirigeants actuels et à venir de l’Europe : de quoi rapprocher base et sommet, ce dont on ne peut que se réjouir !
Reste pour chacune et chacun d’entre nous à se déterminer sur la liste estimée la plus proche de nos attentes : un choix qui, au fond, consiste à déterminer si nous laissons parler nos sentiments ou si nous cédons à nos ressentiments !
En cela, et quel que soit le nombre de postulants, chaque élection présente le même dilemme : il est parfois pénible à trancher, mais les pays arrivés dans notre Europe après 2004 ne manqueraient pas de nous dire quelle chance nous avons de connaître cet examen de conscience et cette difficulté de pouvoir et savoir choisir !
Oui, décidément, l’embarras du choix dans l’isoloir vaut bien les choix de l’embarras face aux scrutins de jadis !
Notre système, en vérité, n’est pas parfait, mais personne n’a prétendu cela ; du moins est-il perfectible, et là est l’essentiel, ce pour quoi nous devons nous mobiliser ce 9 juin !

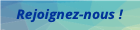
Derniers commentaires