Genèse, contenu, processus de ratification
Le Mercosur (de l’espagnol Mercado Común del Sur ) est une alliance constituée en 1991 par l’Argentine, le Brésil, l’Uruguay et le Paraguay – rejoints par la Bolivie fin 2023. L’Accord de libre échange (ALE) UE-Mercosur, dont les négociations ont commencé en 2000, est le plus important de l’UE et concerne 730 millions de personnes. Il revêt un volet de coopération politique et un volet commercial, sous compétence de la Commission dont nous traitons ici. Après 19 ans de négociations, un accord est conclu mais il est rejeté en 2020 par 6 États-membres (EM) dont la France. En 2022, la Commission voit dans le retour au pouvoir de Lula une fenêtre d’opportunité pour le finaliser. Les négociations reprennent jusqu’en 2024 avec l’ajout d’un protocole additionnel recèlant quelques améliorations : il intègre le climat et un engagement du Mercosur à réduire la déforestation, il met en avant les droits des peuples et leurs conditions de travail et la Commission crée un fonds de compensation d’1 Md d’euros pour les secteurs agricoles fragilisés.
Avec cet ALE, les secteurs les plus stratégiques de chaque partie bénéficieront d’une réduction progressive de 92% des droits de douane sur une période de 0 à 16 ans selon les produits. Du côté des exportations européennes qui représentent 84 milliards (Mds) d’euros et concernent 30 000 entreprises, l’abolition des barrières douanières du Mercosur génèrera un gain annuel de 4 Mds d’euros. Elles concerneront l’automobile, la chimie, la pharmacie, le textile, les cosmétiques, les transports, et les services ainsi que l’accès des grandes entreprises aux marchés publics (eau et énergie). L’UE exportera également des produits agricoles tels qu’alcools, huile d’olive et chocolat ainsi que 357 Indications Géographiques Protégées (IGP dont 64 françaises) dont l’imitation sera interdite au sein du Mercosur : nombreux fromages, beurres, viandes et charcuterie, vins et spiritueux, riz de Camargue, huîtres Marennes-Oléron, pruneaux d’Agen, lavande de Haute Provence. Le Mercosur exportera des produits agricoles dont 99 000 t de viande bovine (quota de 1,6% de la production de l’UE), 180 000 t de viande de volaille (quota de 1,4% de la production de l’UE) et 180 000 t de sucre. Ainsi que des minerais stratégiques (cuivre, lithium, cobalt, nickel, graphite, silicium) dont il détient de grandes réserves : autant de ressources dont l’UE a besoin pour ses technologies vertes (éoliennes, batteries électriques, semi-conducteurs).
Le 6 décembre 2024, Ursula von der Leyen signe l’ALE à Montévidéo, malgré le rejet du gouvernement français, ouvrant un processus de ratification dont les modalités ne sont pas encore fixées : vote de l’ensemble de l’ALE en procédure longue, (Conseil à l’unanimité avec droit de véto, puis Parlement européen (PE) puis Parlements nationaux et régionaux dans les pays fédéraux) ou séparation entre accords commercial et politique, le premier n’étant soumis qu’au vote du Conseil à majorité qualifiée (55% des EM, 65% de la population) et du PE. La France cherche à constituer une minorité de blocage de 4 EM, représentant au moins 35% de la population. Elle pourra compter sur l’Autriche et l’Irlande, voire sur l’Italie et la Pologne.
Quelques réponses aux 3 principales attaques subies par l’ALE
1) Un Accord incompatible avec la lutte contre le dérèglement climatique !
La remise en cause des longues chaînes de valeur et des échanges avec des partenaires lointains a du sens. Cet ordre commercial met en jeu des transports et une consommation d’énergie fortement émetteurs de CO2 et rend la traçabilité de l’impact environnemental des produits beaucoup plus complexe. Les voies de transport optimisées (par ex. maritimes) peuvent rassurer mais les modes de production restent préoccupants : on peut déplorer le modèle d’alimentation d’un élevage européen gavé au soja, largement importé du Mercosur et nuisible à la souveraineté alimentaire de l’UE.
Au delà de cette critique écologique, qui vaut pour l’ensemble de la mondialisation et doit conduire à raccourcir les chaînes de valeur et à relocaliser certaines activités, cet ALE est, avec celui passé avec la Nouvelle-Zélande, le premier à faire du respect de l’Accord de Paris une clause suspensive. Le Mercosur s’y engage à réduire la déforestation. La politique commerciale européenne devient l’un des instruments d’un Pacte Vert en souffrance.
2) « Automobiles contre bétail », l’agriculture est toujours la variable d’ajustement des négociations !
L’agriculture n’est pas une variable d’ajustement : les principes de l’ALE relèvent de l’histoire du commerce et l’échange « agriculture contre industrie » était au cœur de la théorie des « avantages comparatifs » de Ricardo en 1817. Il l’illustrait par les échanges du drap britannique contre le vin portugais, chaque pays se spécialisant dans son secteur le plus compétitif. Au-delà de sa composante agroalimentaire, il faut examiner l’ALE de façon globale dans tous ses bénéfices pour l’UE : industrie, ouverture de marché publics et minerais stratégiques. Un ALE est donnant-donnant, il faut éviter d’opposer les secteurs entre eux. Et s’il est un domaine français où l’agriculture est une variable d’ajustement, c’est la place minimale qui lui est faite dans le partage de la chaîne de valeur alimentaire, allant des producteurs aux distributeurs, que la loi EGALIM ne parvient pas à rehausser.
L’ALE s’inscrit dans un contexte géopolitique qui pèse sur ses négociations. La pandémie, la guerre en Ukraine, le commerce déloyal chinois et le protectionnisme états-unien ont mis en évidence les risques de la dépendance européenne. L’importation de minerais stratégiques du Mercosur permettra à l’UE de diversifier ses sources. Si la pression de négociation sur le Mercosur est trop forte, celui-ci se rétractera et la Chine (premier partenaire commercial du Brésil) sautera sur l’occasion. L’UE, qui peine à relever le défi de sa compétitivité, a besoin de cet ALE.
3) L’Accord autorise l’importation de produits agricoles ne respectant pas les normes européennes, il fragilise certaines filières !
Contrairement à ce qui est souvent reproché, toutes les conditions sanitaires en vigueur dans l’UE s’imposent au Mercosur, en application de l’accord SPS (Sanitary and Phytosanitary Standard) de l’OMC. Les mesures miroirs de la législation européenne s’imposent à tous les ALE, en particulier l’interdiction de la viande aux hormones et de l’usage des antibiotiques ainsi que les LMR (limites maximum de résidus) pour les pesticides. S’y ajoute une clause miroir, spécifique à cet ALE : une suppression des droits de douane sur les œufs, conditionnée au respect des normes de l’UE en matière d’élevage des poules pondeuses. Le risque ne réside donc pas dans la différence de normes mais dans le manque d’efficacité des procédures de contrôle : qu’ils soient effectués sur place par l’Office vétérinaire de la Commission ou aux frontières par les douanes des EM, ils sont réalisés par échantillonnage et l’UE devra progresser sur ce plan (pourquoi pas des organismes certificateurs indépendants ?). Il faut aussi reconnaître la faible prise en compte par le Mercosur du bien-être animal pour lequel seules les conditions d’abattage figurent dans l’ALE. Son instrument de coopération réglementaire permettra de progresser vers un rapprochement de toutes les normes. Et rappelons une donnée structurelle incontournable : les produits agricoles du Mercosur ont des coûts de revient très inférieurs à ceux de l’UE et sont donc plus compétitifs.
L’élevage bovin est un secteur fragile, en régression partout en Europe à l’exception de la Pologne et très affecté par les épizooties et un taux de pauvreté élevé. Il ne faut pas, pour autant, craindre une invasion des marchés européens même si l’exportation se concentre partiellement sur le segment spécifique de l’aloyau : le nouveau protocole à introduit un mécanisme « de sauvegarde » pour protéger les filières fragiles des importations massives. Et l’exemple du CETA montre que, 7 ans après la signature de l’accord commercial, le quota fixé est loin d’être atteint : le Canada a tout simplement augmenté ses exportations vers d’autres pays moins regardants sur les normes. La Commission s’est en outre engagée à mettre en place un fonds de compensation d’1 Md d’euros pour protéger cette filière, avant toute autre.
Dans sa feuille de route sur la PAC post-2027, le commissaire Christophe Hansen a décliné une dizaine de priorités dont deux ont trait aux enjeux ci-dessus : un soutien renforcé à l’élevage et une amélioration des stratégies de négociation commerciale. Espérons qu’elles feront leur chemin.


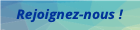
Félicitations Patrick pour cette bonne synthèse d’un accord dont l’analyse, complexe, mérite mieux que les positionnements radicaux de certains acteurs agricoles français. Dans la folle période que nous connaissons, avec la volonté du nouveau Président américain d’augmenter les droits de douane tous azimuts, gardons notre capacité de réflexion sur la plus-value d’un accord qui permettrait à l’Union européenne de diversifier ses partenariats, face à la Chine de plus en plus active en Amérique latine.