Pacte Vert, acte 1 : une forte ambition
Le contexte de l’année 2019 fut déterminant : pression des marches pour le climat et de 2 Initiatives Citoyennes Européennes (ICE) exigeant une législation décourageant l’usage d’énergies fossiles et encourageant les énergies renouvelables ; demande de 8 États-membres (EM), dont la France, de consacrer 25% (au lieu de 20%) du budget européen à l’action climatique ; vote d’un état d’urgence climatique par un Parlement européen à forte composante écologiste.
La Commission européenne se devait donc d’être ambitieuse. Son Pacte Vert, publié en décembre 2019, propose une Stratégie de croissance verte, faisant de l’UE le premier continent à zéro-émissions nettes de GES en 2050, avec un objectif intermédiaire de 55% d’émissions nettes pour 2030. Il touche un large spectre d’activités, se déclinant en 8 domaines : marché carbone, énergie propre, transports durables, zéro pollution, économie circulaire, rénovation énergétique des bâtiments, stratégie agricole et alimentaire, stratégie biodiversité.
Un arsenal législatif et budgétaire massif se met en place avec 7 mesures-phares :
- Amélioration du marché carbone : Le Système d’échange de quotas d’émissions entre les entreprises industrielles (SEQE) se voit ouvert à de nouveaux secteurs : bâtiment, transports maritime et routier, carburants. On l’aligne avec la politique commerciale à travers un Mécanisme d’Ajustement Carbone aux Frontières (MACF) qui assurera une concurrence loyale aux entreprises européennes : les exportateurs vers l’UE paieront un certificat d’émissions rendant leur prix similaire à celui du même produit conçu à l’intérieur du marché unique. S’il vient à bout de difficultés diplomatiques (mesures de rétorsion) et techniques (les entreprises doivent fournir l’intensité carbone de leurs produits), le MACF, entre 2023 et 2030, rapportera 10 milliards (Mds) d’€ par an au budget européen.
- Mobilité durable : des normes plus strictes d’émissions de CO2 pour les poids lourds et les bus ainsi que pour l’incorporation de carburants alternatifs dans les secteurs maritime et aérien sont établies. Surtout, on interdira la vente des véhicules thermiques neufs à partir de 2035.
- Stratégie agricole et alimentaire, dite « De la ferme à la table » fixant des objectifs 2030 très ambitieux : ‑50% d’usage des pesticides, ‑20% d’usage des fertilisants azotés, 25% de la surface agricole en bio (10,5% actuellement) et proposition-cadre sur la transition alimentaire.
- « Vague de Rénovations » : elle propose de rénover d’ici 2030, 35 millions de bâtiments inefficaces au plan énergétique. L’action contribuera à la création d’emplois, à la santé et à la lutte contre la précarité énergétique.
- Stratégie de finance durable : elle vise à réorienter les capitaux vers des investissements « verts ». Elle définit une taxonomie qui établit les critères qu’une activité économique doit remplir pour être considérée comme durable et recevoir des financements. Et elle impose un devoir de vigilance et de responsabilité aux entreprises : la directive Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), en particulier, exige la publication d’informations sur l’impact environnemental et social de leurs activités.
- Deux instruments accompagnent les entreprises et les ménages dans une logique de justice territoriale et sociale : un Fonds de transition juste (17,5 Mds d’€ pour 2021–2027) atténue les répercussions négatives sur l’emploi de la décarbonation de l’économie locale (réhabilitation de sites industriels, reconversion des salariés) en ciblant les secteurs industriels les plus émetteurs, avec, en France, 6 régions concernées ; un Fonds social pour le climat (87 Mds d’€) accompagne les ménages les plus vulnérables via le financement de dispositifs d’aide tels que le bonus écologique à l’achat d’un véhicule électrique ou le chèque énergie.
- Renforcement des financements à 3 niveaux :
-
- 30% du budget 2021–2027 de l’UE (soit 320 Mds) sont consacrés au climat ;
- 37% du budget du Plan de relance économique « NextGenerationEU » (soit 280 Mds), faisant suite à la crise sanitaire, sont consacrés à la transition écologique ;
- avec la transformation, en 2020, de la Banque européenne d’investissements (BEI) en Banque pour le climat, ses prêts dédiés aux gros projets d’équipements de transition verte passent de 18 Mds en 2019 à 30 Mds en 2020. Et elle double le financement de l’adaptation au changement climatique pour le porter à 30 Mds en 2030.
Pacte Vert, acte 2 : un détricotage
La guerre en Ukraine éclate en février 2022, entraînant une crise de souveraineté énergétique et une interrogation sur les capacités de défense qui deviendront vite les priorités de l’UE.
En mai 2023, la France, vite rejointe par 8 ÉM, appelle là « une pause règlementaire » quant aux normes environnementales. Le patronat impute la baisse de compétitivité de l’UE (analysée par le rapport Draghi) au fait que le Pacte est allé trop loin, soulignant que les investissements européens se détournent vers les pays disposant de normes environnementales moins contraignantes.
Avec le retour au pouvoir de Donald Trump, la charge redouble et les appels à déréguler se font plus pressants.
Ainsi, alors qu’une petite moitié des textes prévus ont été adoptés, la Commission cède à la pression et enclenche la marche en arrière sur l’environnement et le climat. La plupart des textes-clés sont reportés, rejetés ou vidés de leur substance. C’est l’objet d’un train de simplification, appelé « Omnibus », enclenché par l’UE début 2025 et composé de 6 paquets législatifs successifs, dont les principaux concernent : l’abandon des objectifs de réduction de l’usage des pesticides et de développement de l’agriculture biologique ; des mesures de flexibilité et un report de la décision concernant l’interdiction de vente des véhicules thermiques à partir de fin 2035 ; une édulcoration et un report de 2 ans de la directive sur le devoir d’information des entreprises (CSRD).
Plus regrettable encore est l’affaiblissement du leadership européen en matière de diplomatie climatique. Alors qu’en 2015, les ÉM faisaient front uni pour l’Accord de Paris sur le climat, leur profond clivage les a empêchés de présenter un objectif intermédiaire (2040) commun de décarbonation lors de la COP 30 qui s’annonce au Brésil. Bon nombre d’entre eux se sont opposés à la proposition de la Commission, consistant à réduire les émissions des GES de 90% d’ici 2040. Et la France en faisait malheureusement partie.
Pacte Vert, acte 3 : la voie du salut ?
L’heure est aujourd’hui à un triptyque « climat-compétitivité-autonomie économique », que symbolise le Pacte pour une industrie propre, proposé par le commissaire français Stéphane Séjourné en février 2025. Il constituera le nouveau volet industriel de décarbonation du Pacte Vert et mobilisera 100 Mds d’€. Il libérera l’investissement en faveur de l’innovation, rendra l’UE plus autonome en produits stratégiques et accentuera les plans de reconversion des secteurs et territoires les plus vulnérables.
Pour réussir cette nouvelle phase du Pacte Vert, l’UE devra affronter des vents contraires : contexte international avec l’offensive chinoise sur les technologies vertes et la guerre commerciale imposée par les États-Unis ; profondes divisions entre ÉM ; forces politiques national-populistes et d’extrême-droite anti-Pacte, au sein du Parlement européen ; coût de conversion trop élevé dans les TPE et les PME, très nombreuses dans l’UE ; obstination des ÉM « fourmis » à limiter le budget du cadre financier 2028–2034 dont les négociations commencent ; et surtout, réticences des citoyens européens à s’approprier un processus dont les objectifs sont partagés mais dont la trajectoire est souvent rejetée car trop contraire aux modes de vie et considérée comme injuste (malgré les efforts du Pacte dans ce domaine). Il y a là une pédagogie à effectuer dans les ÉM, en particulier sur le lien entre climat, économie et santé.
C’est l’une des facettes du fameux sursaut européen dont nous avons tant besoin.


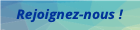
Félicitations Patrick pour cette bonne synthèse, rien de simple à l’horizon !
A l’évidence, rien de possible sans une forte mobilisation (actuellement improbable) au niveau national, pour accompagner l’évolution européenne, y compris au niveau de la « société civile ». Cette question a été discutée aujourd’hui dans le cadre de l’Université d’automne du Mouvement européen France, à Belfort
merci de ce résumé de l’histoire récente et de la mise en perspective des choix d’aujourd’hui. Il y a de sérieuses inquiétudes sur la capacité à tenir le cap et des affrontements féroces y compris au Parlement européen, pourtant si allant sur la question et des votes clés à venir qui font craindre le démantèlement de la directive CSRD