Les différentes législations des 27 États membres peuvent entraîner des disparités en matière d’aides économiques octroyées aux entreprises ou à d’autres entités juridiques. C’est pourquoi le droit des aides d’État vise à encadrer ces interventions publiques, tout en prévoyant certaines dérogations permettant d’accéder aux fonds publics sous conditions.
Toute entité souhaitant bénéficier d’une aide publique – entreprise, association ou collectivité publique – doit régulièrement s’informer de l’évolution du droit européen auprès de l’autorité de gestion compétente. Avant toute demande de financement européen, il convient d’évaluer la conformité de l’aide envisagée au regard des articles 106 à 109 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE).
I. La définition et qualification d’une aide d’État
Selon l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, une aide d’État se caractérise par quatre critères cumulatifs :
- L’aide est accordée par l’État ou au moyen de ressources publiques :
Une aide peut être octroyée directement par l’État, par une collectivité territoriale ou par un organisme public. Elle peut aussi être attribuée de manière indirecte par des entreprises publiques ou des organismes contrôlés par l’État. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a précisé que la notion de ressources publiques inclut également les allègements fiscaux et exonérations (CJCE, 22 mars 1977, Steinike & Weinlig, aff. C‑78/76). - L’aide confère un avantage économique sélectif :
L’avantage accordé doit être spécifique à certaines entreprises ou secteurs d’activité et non à l’ensemble du marché. Par exemple, une exonération fiscale ciblée ou une subvention attribuée à certaines entreprises constitue un avantage sélectif (CJUE, 19 décembre 2018, A‑Brauerei, aff. C‑374/17). - L’aide affecte la concurrence :
Une aide est considérée comme affectant la concurrence lorsqu’elle renforce artificiellement la position concurrentielle du bénéficiaire par rapport à ses concurrents n’ayant pas reçu d’aide. - L’aide affecte les échanges entre États membres :
Une aide est susceptible d’affecter les échanges intra-UE dès lors qu’elle influence la compétitivité d’une entreprise sur le marché intérieur. La CJUE a précisé qu’une aide de faible montant peut également affecter les échanges si elle concerne un secteur concurrentiel (CJUE, 14 septembre 1994, Banco Exterior de España, aff. C‑387/92).
Certaines aides de faible montant échappent toutefois à cette qualification. Les aides de minimis, définies par le règlement (UE) n°2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023, ne sont pas considérées comme des aides d’État si elles n’excèdent pas 300 000 euros sur trois ans pour une même entreprise.
II. Le régime juridique de compatibilité des aides d’État
Si une mesure est qualifiée d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, elle est en principe interdite. Toutefois, certaines exceptions permettent d’autoriser ces aides sous conditions.
A. Les aides compatibles de plein droit
Conformément à l’article 107, paragraphe 2, du TFUE, certaines aides sont déclarées compatibles avec le marché intérieur :
- Les aides à caractère social accordées à des consommateurs individuels, sous réserve qu’elles restent non discriminatoires (ex : aides au logement, RSA).
- Les aides destinées à remédier aux calamités naturelles ou à d’autres événements exceptionnels (ex : fonds d’indemnisation pour catastrophes naturelles, mesures de soutien économique liées à la crise du COVID-19, validées par la Commission européenne dans sa communication du 19 mars 2020).
B. Les aides soumises à dérogation sous conditions
L’article 107, paragraphe 3, du TFUE prévoit des catégories d’aides pouvant être compatibles sous réserve de l’appréciation de la Commission européenne :
- Aides au développement régional : L’UE autorise des aides aux régions les plus défavorisées, notamment celles visées à l’article 349 du TFUE (ex : départements et régions d’outre-mer).
- Aides visant à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre : Exemple des aides aux banques lors de la crise financière de 2008 (CJUE, 11 novembre 2010, Comisión/Scottish Power, aff. C‑124/10).
- Aides pour des objectifs d’intérêt commun : Soutien à l’innovation, à la protection de l’environnement ou aux énergies renouvelables.
C. Les exemptions à l’obligation de notification
Certaines aides sont exemptées de notification préalable à la Commission européenne, en vertu du Règlement Général d’Exemption par Catégorie (RGEC) n°651/2014, modifié en 2023. Ces aides concernent :
- Les aides de minimis mentionnées plus haut.
- Les aides aux services d’intérêt économique général (SIEG) : L’article 106, paragraphe 2, du TFUE autorise les compensations pour des missions d’intérêt général (ex : transports publics, service postal).
- Les aides à la recherche, au développement et à l’innovation : Encouragement des investissements dans des secteurs stratégiques.
En conclusion, l’octroi d’une aide publique à un porteur de projet doit faire l’objet d’une analyse rigoureuse afin de déterminer sa conformité au droit de l’Union européenne. Une aide répondant aux quatre critères cumulatifs de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE est en principe interdite, sauf si elle entre dans l’une des exceptions prévues par les articles 107, 108 et 109 du TFUE. L’autorité compétente devra veiller à la régularité de la procédure, notamment en cas d’obligation de notification préalable auprès de la Commission européenne.
Les entreprises et collectivités doivent donc anticiper ces contraintes juridiques avant toute demande de financement européen, en consultant les règlements applicables et la jurisprudence pertinente.


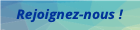
Derniers commentaires